Sans rentrer dans le détail, je ne partage pas un élément de l'analyse : la lecture à l'échelle communale. Cette échelle est un héritage historique et n'est qu'une limite administrative. Elle ne représente pas (ne représente plus) un "bassin de vie". Pour les déplacements, ce "bassin de vie", c'est l'aire urbaine (le cas échéant, voir définition sur Wikipédia ou l'INSEE). Comparer la desserte à l'échelle communale est particulièrement biaisé parce qu'il y a des communes avec des profils très différents. Certaines sont limitées à ce qu'on appelle le chef-lieu, d'autres sont composées de plusieurs hameaux, voire multi-polarisées (avec plusieurs centralités). Dès lors, en comparant les communes, on compare des choux et des carottes.
En deuxième lieu, la politique de déplacements n'est pas définie à l'échelle communale. C'est lié à la raison qu'on vient d'invoquer. Lorsqu'on fait des créations/modifications de réseau, même si les interlocuteurs sont les communes (parce qu'elles correspondent aux limites administratives), on réfléchit à une échelle intercommunale. En général, on suit une logique de "bassin-versant" assez proche de celle de l'eau.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il s'agit de partir d'un fleuve et remonter ensuite ses différents affluents. Les limites du bassin-versant sont alors constituées par l'origine des cours d'eau primaires. Ainsi, lorsqu'on fait une réorganisation de réseau suite à l'arrivée d'une ligne forte, on réfléchit pas à la commune desservie mais à l'ensemble des espaces et lignes existant initialement qui sont concernés.
En disant ça, je ne remets pas en cause le bienfondé des solutions proposées mais je trouve que la partie de l'argumentaire comparant les communes entre elles est biaisée. Si c'est volontaire, c'est de la mauvaise foi mais je n'en suis pas sûr. Si c'est involontaire, ça méritait un argument contradictoire !

... d'autant que la desserte d'un territoire (ou plutôt une portion de territoire parce que la plupart des communes ne sont pas comme Craponne, c'est-à-dire quasi-exclusivement concentrées le long d'un axe) relève d'une alchimie complexe intégrant sa position relative par rapport à d'autres. Par exemple, la ligne 98 passe au bois de l’Étoile. Il n'y a rien là-bas ! Mais c'est un lieu de passage obligé pour un bus un peu direct entre le parc de Lacroix-Laval et le lycée de Charbonnières. Si on reste dans le secteur, d'ailleurs, on aura la réponse à une des différences que tu traites : pourquoi y a-t-il une desserte de soirée à Sainte-Consorce ? Parce qu’il y a une desserte de soirée à Marcy-l'Etoile ! Et pourquoi y a-t-il une desserte de soirée à Marcy-l'Etoile ? Probablement parce qu’il y a là-bas une école vétérinaire avec des logements étudiants et que cette population utilise les TC plus que la moyenne, y compris en soirée. Quitte à envoyer un bus à Marcy-l'Etoile, autant le faire passer à l'aller ou au retour par Sainte Consorce... Enfin, par Saint-Genis-les-Ollières parce que, là aussi, le passage par Sainte Consorce ne concerne qu'un bout de la commune et est dû au fait que la route passe là !
La comparaison des dessertes par le nombre d'habitants des communes est donc - excuse si ça parait violent, ce n'est pas le but - inappropriée. Maintenant, pour le reste de tes propositions, le SYTRAL saura mieux te répondre que moi mais les difficultés sont généralement celles-ci :
x minutes de plus par service, ça fait cher à la fin de l'année !
Une desserte maillée est possible lorsque la densité d’utilisateurs est suffisamment importante pour permettre d'avoir des liaisons (plus) directes vers plusieurs pôles (question de la liaison "C24 vers gare d'Oullins"), ce qui est le cas en centre-ville mais pas vraiment en préiphérie
A ta disposition pour en discuter ou préciser certains points qui paraitraient obscurs !

P.S. Je trouve ta position constructive. ça fait plaisir de voir autre chose que approches revendicatives non étayées.




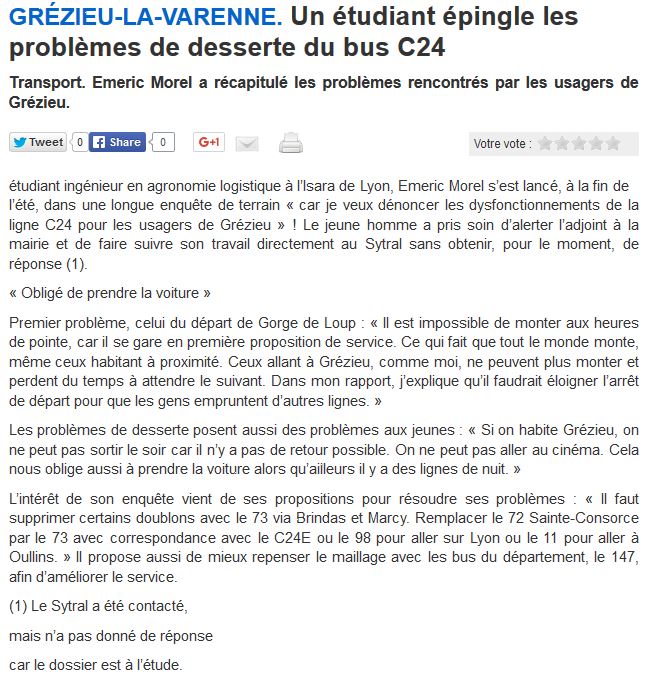
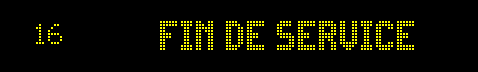
 ... d'autant que la desserte d'un territoire (ou plutôt une portion de territoire parce que la plupart des communes ne sont pas comme Craponne, c'est-à-dire quasi-exclusivement concentrées le long d'un axe) relève d'une alchimie complexe intégrant sa position relative par rapport à d'autres. Par exemple, la ligne 98 passe au bois de l’Étoile. Il n'y a rien là-bas ! Mais c'est un lieu de passage obligé pour un bus un peu direct entre le parc de Lacroix-Laval et le lycée de Charbonnières. Si on reste dans le secteur, d'ailleurs, on aura la réponse à une des différences que tu traites : pourquoi y a-t-il une desserte de soirée à Sainte-Consorce ? Parce qu’il y a une desserte de soirée à Marcy-l'Etoile ! Et pourquoi y a-t-il une desserte de soirée à Marcy-l'Etoile ? Probablement parce qu’il y a là-bas une école vétérinaire avec des logements étudiants et que cette population utilise les TC plus que la moyenne, y compris en soirée. Quitte à envoyer un bus à Marcy-l'Etoile, autant le faire passer à l'aller ou au retour par Sainte Consorce... Enfin, par Saint-Genis-les-Ollières parce que, là aussi, le passage par Sainte Consorce ne concerne qu'un bout de la commune et est dû au fait que la route passe là !
... d'autant que la desserte d'un territoire (ou plutôt une portion de territoire parce que la plupart des communes ne sont pas comme Craponne, c'est-à-dire quasi-exclusivement concentrées le long d'un axe) relève d'une alchimie complexe intégrant sa position relative par rapport à d'autres. Par exemple, la ligne 98 passe au bois de l’Étoile. Il n'y a rien là-bas ! Mais c'est un lieu de passage obligé pour un bus un peu direct entre le parc de Lacroix-Laval et le lycée de Charbonnières. Si on reste dans le secteur, d'ailleurs, on aura la réponse à une des différences que tu traites : pourquoi y a-t-il une desserte de soirée à Sainte-Consorce ? Parce qu’il y a une desserte de soirée à Marcy-l'Etoile ! Et pourquoi y a-t-il une desserte de soirée à Marcy-l'Etoile ? Probablement parce qu’il y a là-bas une école vétérinaire avec des logements étudiants et que cette population utilise les TC plus que la moyenne, y compris en soirée. Quitte à envoyer un bus à Marcy-l'Etoile, autant le faire passer à l'aller ou au retour par Sainte Consorce... Enfin, par Saint-Genis-les-Ollières parce que, là aussi, le passage par Sainte Consorce ne concerne qu'un bout de la commune et est dû au fait que la route passe là !




