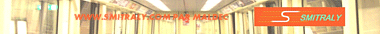Tribune de l'association "Réussir aujourd'hui" :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0 ... 851,0.htmlJe met en marron la partie de la tribune traitant des transports
[size=18px]Retour à Clichy-sous-Bois, par Jean-Claude Barrois[/size]
LE MONDE | 10.11.05 |
Les événements partis de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'interpeller les bénévoles de notre association. Ils interviennent dans quatre lycées de ce département. Notre public hebdomadaire dans les quatre communes – Clichy-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois et Stains –, ce sont ces "jeunes" que les médias stigmatisent par un nom collectif, à la limite du mépris. Ou du moins ceux qui ont la volonté de "s'en sortir".
Un mot pour dire qui nous sommes et l'objet de notre action. Bénéficiant, depuis 2004, d'une subvention dans le cadre de la politique de la ville et, depuis 2005, d'un soutien de la région et du mécénat d'entreprises, notre petite association compte une vingtaine de membres. Tous diplômés de grandes écoles, ils exercent ou ont exercé d'importantes fonctions dans le public ou le privé. Une dizaine d'entre eux occupent, à titre bénévole, les fonctions de "délégués référents" dans les établissements scolaires conventionnés avec l'association.
A ce titre, ils interviennent trois heures chaque semaine dans un établissement. Ils organisent par ailleurs des sorties et du tutorat individualisé via Internet. Ils ont la responsabilité d'une "cohorte" de lycéens – de 10 à 12 – sélectionnés en liaison avec les équipes pédagogiques parmi les élèves les plus brillants et les plus motivés des classes de première ou de terminale. Ce tutorat vise, d'une part, à dispenser, au cours d'un cycle de deux ans, des savoirs fondamentaux nécessaires à l'acquisition d'une "formation citoyenne" et, d'autre part, à acquérir des références qui permettent d'accéder à des filières sélectives de l'enseignement supérieur. Notre expérience est riche de constats.
Aller à Clichy. Qui connaît Clichy-sous-Bois, sinon par la presse depuis quelques jours ? Située à proximité de Paris, cette commune, l'une des plus pauvres de France, a comme caractéristique géographique d'être inaccessible depuis la capitale par les transports en commun – du moins dans des temps décents. C'est, à l'échelle d'une commune, une caricature de ces cités construites entre autoroute et voies ferrées. On ne peut en sortir.
C'est la seule commune de la Seine-Saint-Denis pour laquelle nous sommes contraints de louer un car à chaque sortie scolaire, afin que l'essentiel du temps pédagogique consacré à la visite d'un musée ou d'une usine ne soit pas perdu dans les transports. Il n'est pas surprenant que les élèves s'y sentent exclus du reste de la société. Encore faut-il préciser que les parents sont souvent réticents à laisser leurs enfants s'éloigner de la commune en raison du danger réel ou supposé de l'environnement lointain. Comme toutes les fortifications, cette absence de moyens de transport protège autant qu'elle enferme. Désir d'intégration. Les familles que nous rencontrons expriment une volonté d'insertion sociale dont nous ne trouvons pas trace dans ce que la presse raconte et montre. Elles ont des désirs qui, dans d'autres lieux, paraîtraient d'une banalité affligeante : que leurs enfants puissent s'élever socialement, qu'ils puissent sortir le soir au cinéma sans risquer de se faire agresser, que les efforts consentis pour leurs études leur permettent d'accéder à un emploi décent, une sécurité pour fonder un foyer. On le voit, les désirs exprimés ne sont pas franchement révolutionnaires.
Et pourtant. Pour la majorité des familles que nous rencontrons, ils apparaissent comme un nirvana inaccessible. Il n'est pas surprenant alors que l'aspect chimérique des discours sur l'intégration crée soit un haussement d'épaules, soit une révolte. Les jacqueries des temps modernes sont issues des banlieues parce que, à une vie sans avenir, on ne peut opposer qu'une colère sans limites.
Faut-il le répéter ? Les enfants dont nous nous occupons ont des désirs normaux pour leur âge. Nous ne distinguons pas d'attitudes différentes de ce que nous constatons avec nos propres enfants. Ils sont fans des mêmes stars, écoutent la même musique et ont les mêmes envies.
Plus intégrés qu'ils ne le pensent souvent eux-mêmes, ils souhaitent réussir. Qui dira l'effort que représente, pour un jeune homme ou une jeune fille de 16 ou 18 ans, le fait de consacrer une grande partie de ses loisirs à étudier les fondements philosophiques de la Révolution française ou les arcanes du débat sur l'énergie, plutôt que d'aller jouer au foot ou chiner au centre commercial avec les copines le mercredi après-midi ?
Ils sont motivés et consentent des efforts parfois stupéfiants. Stigmatisés à l'extérieur du quartier par leur look ou, plus simplement, par leur adresse – quand ce n'est pas la couleur de leur peau –, ils risquent de l'être aussi dans leur propre quartier pour non-conformité au modèle télévisuel : parce qu'ils vont au lycée d'enseignement général, parce qu'ils sont bons élèves. Il est vrai qu'un adolescent qui "travaille en classe" ne mérite pas l'attention du "20 heures". On ne peut qu'être las de la surexploitation télévisuelle des banlieues, de ces rondes d'experts qui ne sortent pas de leur bureau. Sur le terrain, nous côtoyons des jeunes gens et des jeunes filles intéressants, attachants, qui méritent mieux que cela. Plutôt que commenter, venez agir !
Des enfants en souffrance identitaire. Notre expérience nous conduit à distinguer les primo-arrivants, récemment arrivés en France, des enfants qui y ont fait toute leur scolarité. Il n'est pas indifférent de noter que les primo-arrivants sont plus nombreux dans les établissements de Clichy-sous-Bois que dans ceux du département où notre association est présente. Nous avons, parmi notre public, des enfants arrivés en France quelques années plus tôt qui additionnent les lauriers scolaires et les félicitations. Pourtant, ces adolescents sont souvent perdus et sans repères parce qu'ils ne connaissent pas le b.a.-ba des références culturelles qui font le lien social national.
La situation est différente pour ceux qui ont fait l'intégralité de leur cursus scolaire à l'école primaire et au collège. Grâce à un enseignement – qui n'a pas démérité de ce point de vue –, ces bons élèves ont accumulé le bagage indispensable pour décoder la société française. Plus nombreux à Clichy-sous-Bois, les enfants sans repères font, à l'évidence, le lit des rumeurs, puis des dérapages. C'est un lieu commun de rappeler que l'adolescence est l'âge de la contestation. Dans le "qui suis-je ?" de ces enfants ressurgit la rupture familiale de l'émigration récente, le rejet du voisinage, la suspicion de la police. Que, dans ces conditions, un certain nombre d'entre eux vacillent dans le repli identitaire n'est guère surprenant. Mais, succès du modèle républicain, la plupart des élèves dont nous nous occupons croient à l'égalité des chances et à la promotion sociale – même s'il leur arrive parfois de douter. Ils sont prêts à se dépasser pour y parvenir.
Le rapport à la police. Parmi les élèves que nous suivons, certains sont issus de familles dont les parents ont plutôt réussi. Ils ont accédé à des emplois intermédiaires, sont parfois devenus propriétaires de pavillon ou vivent dans des immeubles entretenus. Les enfants sont scolarisés et, malgré cela, développent un sentiment de rejet. Ecoutons l'un d'entre eux, habitant d'une zone pavillonnaire.
" Je ne peux pas jouer au foot dans la rue avec mes copains. Chaque fois que nous sortons, les voisins appellent la police pour se plaindre des étrangers qui ne sont même pas du quartier... Cela arrive plusieurs fois par semaine et, chaque fois, la police nous demande nos papiers." Au quotidien, le racisme est à l'oeuvre pour donner à cet enfant, que toutes les statistiques classent comme logiquement intégré, un sentiment de rejet. Comment pourrait-il se sentir français si l'environnement agit sans cesse comme s'il ne l'était pas ? Pour citer Sartre, on est toujours "juif" (lire aussi maghrébin, noir...) "par le regard de l'autre" .
D'autres situations se répètent.
" Quand on vient porter plainte, on nous dit de rentrer chez nous et que ce n'est pas la peine" ; "J'ai porté plainte, j'ai été menacé par les autres jeunes pour que je retire ma plainte." On a peine à s'imaginer l'omniprésence de la violence dans leurs rapports sociaux. Ne nous trompons pas, avant de faire peur, ces enfants ont peur !
Cet effet de répétition crée un rapport très particulier à la police. Alors que nous avions organisé une sortie de plusieurs jours sur le thème des deux guerres mondiales, notamment à Verdun (Meuse) et Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne), notre autocar est tombé en panne. Les gendarmes de l'autoroute A4 sont arrivés pour mettre les enfants en sécurité. Ils ont organisé avec courtoisie et efficacité une rotation avec leurs véhicules pour les emmener dans un bâtiment du péage le plus proche. En moins de quinze minutes, tous étaient à l'abri grâce au professionnalisme de ce peloton de gendarmerie. Situation normale où chacun fait normalement son travail.
Pourtant la vue des uniformes a plongé certains de nos protégés dans un état de stress inattendu. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils voyaient "l'autorité" faite pour servir et non pour réprimer ! Du débriefing de cet incident et de leurs réactions, le constat s'impose que leur rapport à la police ne peut être normalisé que sur le long terme. L'affirmation selon laquelle des jeunes qui fuient la police ont forcément quelque chose à se reprocher fait fi du vécu accumulé et du ressentiment qui se stratifie jour après jour.
Le rapport à l'école. Critiquer le monde enseignant est à la mode. Pour notre part, nous rencontrons des personnels motivés, voire très engagés. Ce constat n'enlève rien au fait que les professeurs de ces établissements sont le plus souvent en début de carrière, qu'ils tournent trop vite et que l'institution ne sait pas récompenser leurs efforts. Par rapport au lycée que nous-mêmes avons fréquenté à la fin des années 1960, les établissements d'aujourd'hui sont devenus un monde sans adultes. Plus exactement, la disponibilité des adultes y est limitée dans le temps. Les enseignants sont accessibles dans leur classe, mais ils sont confrontés aux contraintes des programmes scolaires. Pourtant, il s'agit, le plus souvent, de la seule référence française de ces enfants de familles immigrées. Voilà où des moyens supplémentaires seraient nécessaires d'urgence.
Le déni de la réalité vécue par ces enfants, en France, nous semble être le dernier refuge d'une société bien-pensante, laquelle se contente d'afficher des principes pourtant bafoués au quotidien. Pour traiter un mal, la première des conditions est de poser un diagnostic précis. Aujourd'hui, la France est partiellement ghettoïsée ; l'attitude de certains de nos compatriotes est ouvertement raciste ; les extrémismes de toutes tendances font leur miel des écarts entre affichage et réalité ; la peur du lendemain crée des réactions de rejet et de repli qui ne font qu'aggraver les inégalités.
C'est en acceptant la réalité que des politiques efficaces pourront se mettre en place. Sinon nous devrons prendre l'habitude de ces jacqueries, seules soupapes à la colère et à l'injustice.
D'autres informations sur cette association :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=cli ... ir&spell=1 jean-claude.barrois@wanadoo.fr